Il veut refaire la photo parce que, l’autre jour, il a dû garder l’appareil ouvert longtemps à cause de la lumière moche (un spot unique fait tomber du plafond une douche blafarde). Résultat : je suis flou. Cette fois, il a emporté son pied pour travailler dans de meilleures conditions. Je dis : « Ça évitera que tu trembles, oui, mais ça n’empêchera pas que je bouge » — alors qu’il faudrait que je reste immobile comme les modèles du XIXᵉ siècle que le photographe attachait à leur fauteuil. Je plante mes pieds au sol, dans le couloir de l’immeuble, entre les ascenseurs, devant le miroir, pendant que Joël passe un temps infini à calculer, puis peaufiner ses réglages. Je remarque dans le miroir que la lumière zénithale projette des ombres bizarres sous mes lunettes ; je demande à Joël s’il faut les retirer ; il me répond de faire selon ma préférence. J’hésite. Sans lunettes, je ne suis plus totalement moi ; mais, puisque nous sommes revenus dans ce lieu que j’habitais autrefois (c’est l’essence même du projet) et que je ne portais pas de lunettes quand j’étais enfant… Je peux donc les ranger. Et je ne vois plus rien. Je ne dois pas remuer une paupière pendant toute la pose. Une seconde. Deux secondes. C’est interminable. Il demande : « Tu ne t’ennuies pas ? » Non. Je ne sais pas combien de temps passe. Je ne suis même plus avec lui. Je suis parti dans un état second. N’est-ce pas étrange de rester rivé face au miroir, sans y distinguer son reflet ? Je ne fais jamais ça. Ou alors : d’assez près pour me voir quand même, nu dans la salle de bains. Mais ici, je contemple une glace trop lointaine : une grande glace habitée par une forme floue, à trois mètres de mon corps net — une vague silhouette de moi-même, sans doute, mais comment en être sûr ? L’arrière-plan pâle irradie comme un halo, une bulle claire se dilate dans l’interstice entre mon bras et mes côtes. Impossible de poser mes yeux sur quoi que ce soit, et donc de faire la mise au point ; concentration sur une forme abstraite, comme ces compositions géométriques censées surgir en trois dimensions, à force de loucher sur le papier. Ma focale biologique s’évade vers les taches de plus en plus imprécises — et soudain, mon double se dédouble. D’un reflet, j’en vois deux, qui s’écartent, puis s’approchent. Couleurs, auras, mirages. Je ne bouge pas, car Joël prévient : « J’en refais une, de deux secondes. » Mon corps reste immobile mais, intérieurement, je vacille (ou je m’envole) : c’est vertigineux. Est-ce que cela se verra, sur l’image ? Nous étions venus ici dans l’intention d’improviser. De laisser venir les fantômes. Mais la première fois, je n’ai rien vu. Il a fallu une pose longue pour qu’ils se montrent.
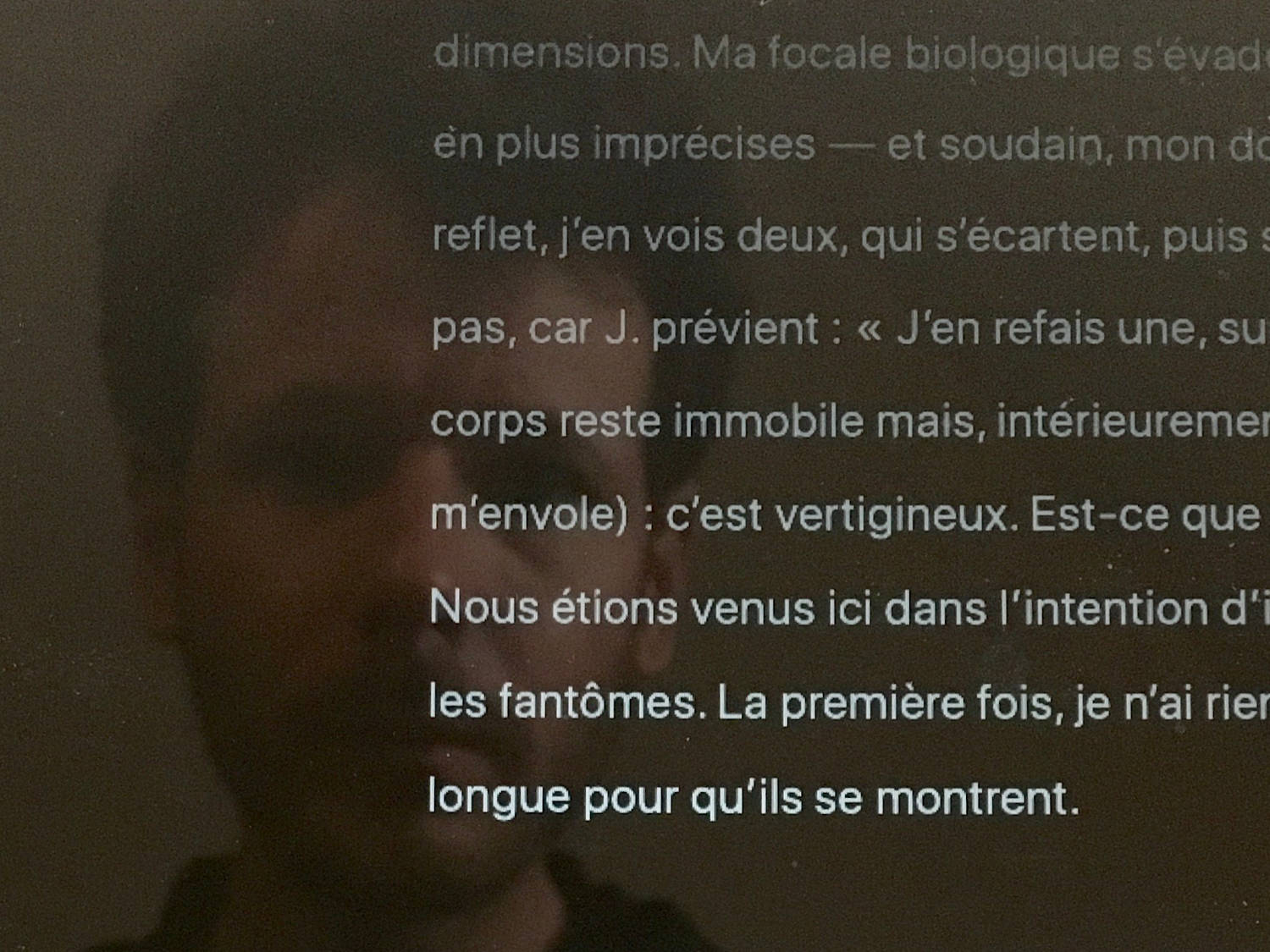
Je parle à H. de cette sensation bizarre ; il me répond qu’il pose toujours sans lunettes. Il dit aussi : « Je ne me sens pas moi sur ces images » et puis : « Les lunettes font partie de mon identité. » Nous avons cette discussion dans un bar. Il est près de minuit. Pourtant, nous avions rendez-vous cinq heures plus tôt : de quoi avons-nous donc parlé, avant ce tête-à-tête ? On s’est retrouvés dans une galerie, il y avait une lecture, il connaissait l’auteur (ses mots, mais pas l’homme), il m’a demandé : « Ça te dit ? » J’ai répondu : « Pourquoi pas. » Ça a commencé comme ça. On ne fait aucun programme pour la suite : encore une histoire de flou. Alors, quand le poète et ses amies poétesses nous proposent un verre dans le rade d’à côté (je peux dire « le rade », car c’en est un, une survivance, dans ce quartier si snob et aseptisé), je dis d’abord oui (je suis curieux), puis non (je suis timide), puis oui (car c’est idiot de fermer la porte au hasard : nous avions convenu d’improviser, H. et moi : dont acte). Ainsi cette rencontre a-t-elle lieu, joyeuse et surtout pas snob : je n’ai lu les œuvres de personne, et personne ne sait qui je suis ; nous avons en commun d’être disponibles, au moins pour quelques heures, et l’envie de laisser advenir. C’est bien. C’est bien, aussi, que ça ne dure pas toute la nuit. C’est donc fini, et voici le tête-à-tête avec H., les lunettes de l’un face aux lunettes de l’autre. Pose longue.
Comment font-ils, les gens qui n’ont pas de temps ? Qui sont obligés de planifier des rencards trois semaines à l’avance, ou de se rendre à des déjeuners relations publiques pour rencontrer d’autres humains ? Les fantômes et les anges annonciateurs ont besoin d’espace et de temps pour apparaître. Les coïncidences se nouent dans l’invisible, puis nous sautent aux yeux brusquement : une rencontre ! Comment renoncerais-je à la liberté que j’ai aménagée, impatiemment, dans ce dessein précis ? Pourquoi renoncerais-je, après l’avoir goûtée si fort ? J’ai besoin de ce temps. Un temps long, afin que des fulgurances s’y faufilent : le lent espace diffus qui accueillera l’étincelle.

Dans Rue des Batailles, un chapitre en friche depuis des mois : le numéro 34 (sur quatre-vingts) doit se passer à Épinal. La première apparition de Jules, mon personnage principal : enfin ! alors qu’on est rendus quasi à la moitié. J’avais posé mes idées dedans, en vrac, en octobre, puis je me suis occupé d’autres chapitres, dans le désordre. Ces dernières semaines, je n’ai pas travaillé une seconde à ce chantier (frustration). J’ai passé plus de temps à écrire à propos de lui (dossiers de candidature pour des bourses, des résidences) qu’à l’écrire pour de vrai (absurdité). Alors, joie de m’y remettre. J’ouvre le chapitre 34, je relis mes notes sur Épinal. Ça devait être une histoire de château démoli, dont les pierres ont servi à bâtir les maisons, et surtout la caserne où vit Jules avec sa famille — sur le concept de « rien ne se perd, rien ne se crée, etc. » — écho aux études de chimie du frangin, dans le chapitre suivant. Ça se tient. Je peux écrire ça. Mais c’est un peu ennuyeux. Et puis : c’est le chapitre où apparaît le personnage principal… Il faut que quelque chose d’important s’y passe. Une scène primitive. Jules a cinq ans. Il joue à cache-cache. Il trouve la planque idéale sur cette colline au château éboulé. Il attend longtemps qu’on vienne le chercher. Plaisir d’être si bien dissimulé : il goûte à sa liberté conquise. Il échappe à la surveillance de sa grande sœur. Il peut faire ce qu’il veut. Tout seul. Seul ! Pourquoi personne ne vient-il le débusquer ? On ne s’inquiète donc pas de son absence ? Jules a voulu la liberté, il n’a pas voulu qu’on l’abandonne… Quelle différence ? Pourtant, nulle indifférence de la part des adultes : au contraire, on veille à distance sur la cachette du petit ; on respecte sa disparition volontaire. Et le petit, grisé par le jeu, s’enrichit d’un amer savoir : le monde peut tourner sans lui. J’écris cette scène aujourd’hui, dans le chapitre entamé cinq mois plus tôt. Interminable chantier. Il fallait ce temps long, sans doute, pour que l’image advienne.
Laisser un commentaire